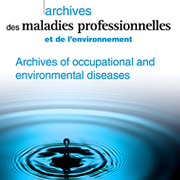Le terme de « psychopathologie du travail » apparaît en 1952, sous la plume de Paul Sivadon dans un article de L’évolution psychiatrique (Sivadon, 1952). Il signale pour la première fois l’existence d’un ensemble de pratiques novatrices et de questionnements qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, unit une poignée de psychiatres militants autant qu’il les divise.
En effet, ce que l’on appelle aujourd’hui psychopathologie du travail, renommée depuis peu « psychodynamique du travail », recouvre à l’époque des interrogations plurielles, indissociables des débats idéologiques et doctrinaux qui agitent la psychiatrie et des transformations que connaît la société française à la même époque. D’une certaine manière, il s’agit encore d’une psychopathologie du travail à l’état natif, oscillant entre pratiques cliniques et théorie de la pratique, entre thérapeutique, expertise et critique sociale.
On aurait tort, cependant, de considérer cette première étape comme une sorte de préhistoire largement dépassée tant les interrogations levées par ces premiers fondateurs de la psychopathologie du travail que furent Paul Sivadon, Louis Le Guillant et Claude Veil, font partie intégrante de l’héritage légué à la « seconde fondation » et continuent de nourrir les débats actuels en psychologie du travail. Certes, l’arrière-plan social est bien différent, mais il correspond également à une configuration singulière ouvrant sur une série de ruptures : tensions doctrinales, d’abord ; remise en cause de l’institution asilaire et mise en œuvre de thérapeutiques actives – sociothérapie et ergothérapie –, ensuite ; décentrement et élargissement de la clinique psychiatrique en direction du travail « réel », enfin. Pourtant un regard rapproché sur ces différentes innovations laisse apparaître que le transfert des leçons des thérapeutiques actives vers le travail réel ne va pas de soi et que le moment de ce passage donne lieu à de multiples effets de brouillage. C’est ce décalage, historiquement daté, entre clinique hospitalière et clinique du travail que l’on voudrait ici souligner, car il semble révéler par défaut l’existence d’une dimension essentielle : le rapport au travail réel comme registre spécifique de la vie subjective.
La question reste posée de savoir si, cinquante ans plus tard, les postures et les schèmes de pensée qui ont conduit à cette occultation ne continent pas de hanter la clinique psychothérapeutique et psychanalytique, aujourd’hui confrontée aux retombées des mutations de la sphère du travail.
Rupture avec les pratiques et les savoirs hérités
La naissance d’une psychopathologie du travail sous la bannière de la psychiatrie est aujourd’hui fait acquis. À l’époque, cela n’avait pourtant rien d’évident. Cette minorité de psychiatres conduits à s’intéresser aux potentialités thérapeutiques de l’activité chez les malades mentaux, puis aux troubles psychopathologiques en rapport avec le travail, appartiennent à la génération du « tournant dynamiste ».
Nés entre 1900 et 1910 (à l’exception de C. Veil qui appartient à la génération suivante) ils ont été formés par les grands maîtres de l’École de Paris tels de Clérambault, Édouard Toulouse, Henri Claude, Georges Heuyer. À cette date, il s’agit encore de concilier une conception organiciste des maladies mentales avec une approche plus dynamique de la psychose largement inspirée par la psychologie pathologique de Janet, la phénoménologie allemande, et leur douloureuse confrontation à la psychanalyse. C’est dans ce climat théorique incertain qu’Henri Ey en viendra à proposer une sorte de troisième voie doctrinale : le modèle organo-dynamique (Ey, 1975), replaçant la maladie mentale dans une perspective à la fois génétique et dynamique de l’organisation de l’être humain, c’est-à-dire un processus de différenciation et de complexification progressive du système nerveux entendu comme système hiérarchisé et intégré de « fonctions ». La maladie mentale correspondrait alors à une « désorganisation » ou « dissolution » des fonctions nerveuses supérieures, c’est-à-dire une « régression du développement psychique » et une réorganisation à un niveau de fonctionnement inférieur. Le grand saut opéré par H. Ey consiste à considérer que la vie psychique est ancrée dans l’organique mais qu’elle constitue un registre autonome répondant à des règles de fonctionnement spécifiques. Par ailleurs, cette conception de la maladie mentale fait désormais place à une altération des « fonctions de relation », suivant une étiologie relevant selon les cas d’une atteinte du substrat fonctionnel ou d’une formation réactionnelle qui a un sens et où les événements vécus et les conflits jouent un rôle central.
Cette reconnaissance de la dynamique subjective à l’œuvre dans le processus morbide sera le premier levier de la psychopathologie du travail. Elle signera par là même la rupture avec les approches positivistes et objectivantes de la psychologie appliquée au travail qui s’est développée depuis les années 1910-1920 dans le sillage de la psychologie expérimentale.
Néanmoins, ces évolutions doctrinales ne vont pas sans tensions ni débats virulents attisés par la diffusion de la théorie freudienne, puis par l’apparition d’un courant sociogénétique d’obédience marxiste, inspiré du matérialisme historique, comme en témoignent les actes du colloque de Bonneval, organisé en 1946 à l’instigation d’Henri Ey, sous le titre interrogateur Le problème de la psychogenèse des psychoses et des névroses (Bonnafé, Ey, et al.). À Henri Ey, qui définit la psychogenèse comme le plan de l’activité psychique normale, « véritable et libre », c’est-à-dire réalisant la subordination de l’organique par le psychique, Jacques Lacan oppose le principe d’une « psychogenèse pure », entendue comme causalité psychique de la maladie mentale, et postulant que « la folie est un phénomène de la pensée ». De leur côté, Sven Follin et Lucien Bonnafé renvoient les deux protagonistes dos à dos et proposent une approche de la folie étayée sur la méthode du matérialisme dialectique : l’objet de la psychiatrie n’est plus la folie mais « l’homme psychopathe en tant que phénomène social », selon une formule empruntée à G. Politzer, et ce sont les facteurs du milieu, l’enchaînement des situations vécues qui constituent le « drame » de l’homme aliéné.
Le colloque de 1946 condense les clivages qui vont traverser la psychiatrie dans les années à venir, et les premières formulations d’une psychopathologie du travail porteront la marque de ces débats internes non dépassés. À ces divisions théoriques, il faut encore ajouter la condamnation de la psychanalyse par le Parti communiste en 1949 et le climat de guerre froide qui vont contribuer à l’isolement des psychiatres communistes.
Paradoxalement, c’est aussi à cette époque que se dégage une visée unitaire que l’on pourrait qualifier de visée humaniste de la psychiatrie. D’une part, une même exigence de pensée conduit une minorité de psychiatres à élucider, par des voies différentes, l’interaction des relations bio-psycho-sociales qui caractérisent à la fois l’unité de l’être humain et la complexité des troubles mentaux ; d’autre part, ce mouvement d’engagement unitaire est entretenu par une remise en cause radicale de l’institution asilaire dont les événements de la guerre ont dévoilé de manière crue le caractère « concentrationnaire ». Pour ces militants que furent Georges Daumézon, Henri Ey, Paul Balvet, François Tosquelles, Paul Sivadon, Louis Le Guillant, Lucien Bonnafé…, l’ancien asile, lieu de relégation et de chronicisation ne pouvait devenir hôpital psychiatrique que si les psychiatres s’engageaient à soigner les malades en vue d’une « sortie » rapide, à accompagner leur réinsertion dans les milieux de vie et de travail, et en deçà, à prévenir la maladie mentale dans la collectivité.
En cette période de pénurie matérielle et thérapeutique (les neuroleptiques n’existent pas encore), les activités collectives au sein de l’hôpital vont devenir le pivot de l’acte thérapeutique, à ce point que Daumézon n’hésite pas à écrire à l’adresse de ses collègues qu’« il convient d’annexer à la vieille recherche clinique […], et sans doute de substituer à elle, une clinique d’activités ». Toutes sortes de tâches, d’échanges et d’événements collectifs sont institués en activités thérapeutiques en même temps qu’un espace commun est transformé en Club des malades. Ainsi s’organisent les premiers supports de la « sociothérapie ». Parallèlement certains lieux sont réservés au « travail thérapeutique », réalisé individuellement ou collectivement, à visée expressive ou productive. Toutes ces activités ont un caractère thérapeutique parce que, génératrices de rencontres, de paroles et de productions, elles constituent autant de « médiations » entre le malade et son monde, le malade et les autres, et représentent autant d’occasions de restaurer les capacités relationnelles altérées par la psychose ou l’épisode délirant.
Certes, il s’agit là de tentatives ponctuelles, empiriques, soutenues par l’engagement et la conviction d’une minorité de psychiatres à l’encontre des pratiques dominantes en cours dans la plupart des anciens asiles. Pourtant, grâce à la ténacité de Sivadon, qui est également à cette époque secrétaire de la Ligue d’hygiène mentale et médecin-contrôleur de la Sécurité sociale, deux Centres de traitement et de réadaptation sociale (ctrs) seront créés à titre expérimental, l’un dans son propre service à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, en 1947, l’autre à l’hôpital de Villejuif, en 1949, dans le service de Le Guillant.
…
Lire la suite sur le site www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes