Propos recueillis par Maud Navarre, du magazine Sciences Humaines
L’être humain est confronté à des conflits psychiques qui proviennent en partie de ses relations sociales. Pour les résoudre, le sociologue Vincent de Gaulejac a inventé une méthode combinant démarche clinique et recherche.
Vincent de Gaulejac développe depuis les années 1970 une riche réflexion sur les maux qui marquent notre époque. La névrose de classe, les sources de la honte, le coût de l’excellence, les paradoxes du capitalisme (par exemple, faire plus avec moins) ou encore, dans son dernier livre, les nœuds sociopsychiques… V. de Gaulejac analyse les contradictions qui traversent nos vies, qui créent des tensions psychiques et sociales.
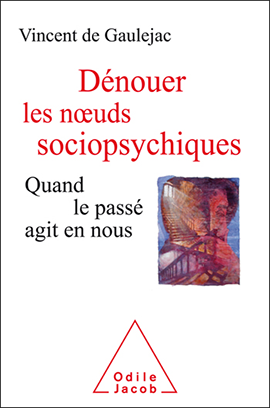
Son approche s’inscrit dans le courant de la sociologie clinique qui introduit la démarche clinique en sociologie pour explorer la dimension existentielle des rapports sociaux et les relations entre l’être de l’individu et l’être de la société.
Puisant ses origines dans le freudo-marxisme, le Collège de sociologie et de la psychosociologie, la sociologie clinique s’est déployée dans de nombreux pays, notamment en Amérique du Nord, du Sud et en Europe, jusqu’en Russie.
L’œuvre foisonnante de V. de Gaulejac a contribué à nourrir en France ce courant qui propose non seulement de comprendre les origines des problèmes humains, mais aussi d’y remédier. Rencontre avec un sociologue ambitieux, mais aussi modeste et pudique.
Votre dernier livre s’intitule Dénouer les nœuds sociopsychiques. Qu’est-ce qu’un nœud sociopsychique ?
J’avais amorcé l’analyse des nœuds sociopsychiques dans La Névrose de classe pour décrire comment les personnes qui changent de position sociale vivent des conflits d’identité liés à la fois à des habitus déchirés, selon l’expression de Pierre Bourdieu, à des conflits de loyauté associés à des sentiments de honte et de culpabilité. La névrose de classe désigne ce mal-être des personnes qui ont connu une forte ascension sociale ou au contraire, un fort déclassement et vivent dorénavant dans un milieu qui ne correspond plus aux repères moraux qu’ils ont acquis pendant l’enfance. Le nœud sociopsychique est donc un concept pour décrire ces conflits, ces tensions qui nous frappent et dont on a du mal à identifier les causes car elles se situent à la frontière entre le social, le psychique et l’intrapsychique. L’idée de nœud renvoie à l’intrication de faits complexes qu’il convient de comprendre pour pouvoir s’en dégager.
La démarche de sociologie clinique analyse cette complexité mais aide également les personnes à s’affranchir des conflits qui les inhibent.
L’idée du nœud est une métaphore : elle renvoie à une pelote, avec plein de fils. Si on ne tire qu’un fil, on resserre la pelote. Il faut donc tirer avec délicatesse un fil, puis un autre, etc. Le psychosociologue Max Pagès appelait cela la problématisation multiple. Cette démarche m’a inspiré. Pour aborder une réalité complexe, il ne faut pas être unidimensionnel. Il faut utiliser toutes les théories à notre disposition, qu’elles viennent de la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, l’économie, l’anthropologie… C’est en combinant ces différentes approches qu’on peut comprendre les conflits et les contradictions de nos sociétés hypermodernes.
Comment identifie-t-on ce nœud ?
Les nœuds sociopsychiques ont pour caractéristique d’engendrer des conflits répétitifs. L’individu ne sait pas très bien si ses conflits viennent de lui ou du travail, de la famille, de l’histoire… Il y a une dimension intérieure et extérieure. « Je » (moi, le sujet) sais que je ne vais pas bien, mais en suis-je responsable ? Dois-je aller en psychothérapie, car il s’agit d’un mal-être personnel, en psychanalyse pour explorer les enjeux inconscients ou dois-je changer ma situation sociale (travail, couple, famille, engagements sociaux…) qui est aussi responsable de ces problèmes ? La plupart du temps, les trois causalités sont justes : c’est l’intrication entre les registres psychologique, familial et social qui est vraiment explicative.
Pour soigner ces tensions, vous avez initié les groupes d’implication et de recherche. En quoi consistent-ils ?
Il s’agit de petits groupes de volontaires réunis pendant trois ou quatre journées, pour mener un travail sur leur histoire personnelle, familiale et sociale. L’idée est de proposer un cadre pour aider les gens à travailler sur leurs conflits personnels.
Le premier groupe que j’ai créé s’intitule « Roman familial et histoire sociale ». Le but est de retracer l’histoire familiale pour voir comment elle peut influencer nos choix amoureux, professionnels, idéologiques. Ce qui renvoie au départ à des problèmes singuliers éclaire en fait des processus sociaux, la condition humaine, notre rapport collectif au monde et à l’histoire. C’est pourquoi le groupe d’implication et de recherche est aussi un outil de recherche sociologique, anthropologique et historique pour comprendre de grandes transformations sociales.
La démarche repose en grande partie sur la capacité des participants à raconter leur vie aux autres et, ainsi, croiser les regards sur une situation conflictuelle afin d’en comprendre les origines et les effets. Pour autant, peut-on vraiment tout raconter ? Parfois, raconter son histoire personnelle peut être difficile…
Bien entendu, il y a des personnes qui ont une maîtrise de la parole plus grande que d’autres. Il y a ceux qui veulent parler d’eux et ceux qui ne le souhaitent pas à cause d’un traumatisme, de la honte… C’est pourquoi, dans les groupes d’implication et de recherche, on installe un cadre pour créer une enveloppe sécurisante et favoriser l’expression individuelle. Il faut que les gens se sentent en confiance, en sécurité. On bannit l’évaluation ou le jugement. L’anonymat et la confidentialité sont garantis. Il est ainsi possible de travailler avec des publics très variés, y compris ceux dont on peut penser qu’ils auraient du mal avec cette méthode.
Par exemple, des mères d’enfants jihadistes m’ont demandé d’animer un groupe. Elles se disaient « envahies par la honte et la culpabilité ». L’expérience a permis à ces femmes de prendre conscience qu’elles n’avaient pas su transmettre l’histoire familiale à leurs enfants : l’histoire des grands-parents qui ont lutté pour sortir de la pauvreté au Maghreb ; des parents travailleurs immigrés qui ont lutté pour que leurs filles fassent des études et s’insèrent en France ou en Belgique. Le groupe d’implication et de recherche leur a donné des outils pour mettre des mots sur ces histoires familiales problématiques, que ces mères ne parvenaient pas à partager avec leurs enfants. Elles ont pu retrouver suffisamment de confiance, d’estime de soi et se sont ensuite engagées dans un programme de prévention pour éviter le basculement des jeunes dans la radicalisation.
À travers l’expérience de ces groupes, vous cherchez à montrer que l’individu est le fruit d’une histoire qu’il cherche à s’approprier. N’est-ce pas aussi une injonction sociale : devenir maître de soi-même, de son histoire, pour advenir en tant que sujet ?
Dans notre société individualiste, chacun est incité à devenir autonome, à être responsable de ses choix, de ses réussites comme de ses échecs. C’est un des pièges de l’idéologie de la réalisation de soi-même. Richard Sennett disait qu’avec le développement de l’individualisme, le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau. J’ajouterais qu’avec le développement du capitalisme néolibéral, le moi de chaque individu est devenu un capital qu’il faut faire fructifier. Vous devez être performant sur tous les registres pour devenir un « premier de cordée ». Et malheur aux « losers » qui ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes s’ils ne réussissent pas.
Il y a là une contradiction : d’un côté, l’idée que chaque individu peut advenir comme sujet de son histoire ; de l’autre, celle qu’il est inscrit dans une histoire qui détermine sa destinée. La sociologie clinique aide à comprendre et à affronter cette contradiction.
Votre démarche s’applique aussi aux chercheurs : vous les poussez à faire leur « egohistoire » pour qu’ils développent leur objectivité. Pourquoi ?
J’anime un séminaire « Histoire de vie et choix théoriques » à l’université de Paris depuis vingt-cinq ans. Ce séminaire propose aux chercheurs de réfléchir aux liens entre leur métier, leur façon de faire de la recherche, leurs options méthodologiques et leur histoire personnelle, familiale, sociale. On a accueilli plus de quatre-vingts personnalités des sciences humaines : Georges Balandier, Alain Touraine, Michel Crozier, P. Bourdieu, Edgar Morin, Robert Castel… Toute cette génération qui a incarné la sociologie. On reçoit aussi des chercheurs d’autres disciplines : l’anthropologue Françoise Héritier, l’historien François Dosse, le physicien Étienne Klein, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, les psychanalystes Roland Gori et Cynthia Fleury…
Il s’agit d’explorer dans quelle mesure la façon de produire de la connaissance entre en résonance avec l’histoire du chercheur, les mondes sociaux qu’il a traversés, les épreuves qu’il a rencontrées, les choix subis ou voulus qu’il a effectués.
…
Lire la suite de l’entretien sur le site Sciences Humaines
Consulter le site web de Vincent de Gaulejac : https://vincentdegaulejac.com/



![[LIVRE] Prévenir et soigner le burn-out « pour les Nuls »](https://www.souffrance-et-travail.com/wp-content/uploads/2022/05/prevenir-le-burnout-marie-peze-2022-400x250.png)

![[LIVRE] « VOUS N’AVEZ PAS LE PROFIL REQUIS. En finir avec la placardisation »](https://www.souffrance-et-travail.com/wp-content/uploads/2024/02/profil-requis-400x250.jpg)