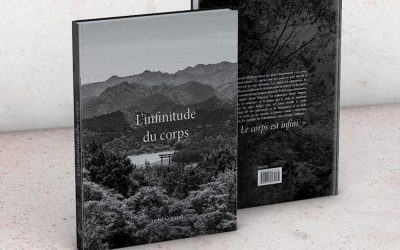Éric Hamraoui, Maître de conférences HDR en philosophie au Cnam (CRTD)
Et si l’on mettait un terme au mot de « retraite »? C’est la proposition originale que formule Eric Hamraoui en clôture de notre dossier retraites. Pensés sur le registre de l’opposition, voire de la dichotomie, le temps de la vie active et de la retraite semblent aussi irréconciliables que la Cigale et la Fourmi, l’un étant voué à produire des richesses, l’autre à en être le profiteur oisif… l’un comme un temps aliéné aux impératifs de production, l’autre comme un refuge à soi où le temps se conjugue enfin au présent. « Vivre obstinément pour la vie », tel est le message d’Eric Hamraoui, appelant à hybrider les âges de la vie et faire de la retraite un aiguillon pour repenser notre rapport au monde, à la manière d’éternels enfants dont chaque jour est celui d’une nouvelle vie…
Nous avons coutume d’opposer le temps de la retraite à ceux de nos vies de formation et de travail. Tandis que le premier serait l’occasion de jeter un regard sur notre vie passée, à la manière de la vision que procure le dimanche sur la semaine dans le livre de la Genèse, les deux secondes seraient tout entières consacrées à l’acte d’invention et de production de soi. Faute d’avoir appris à s’hybrider durant la période de notre vie professionnelle ou de recherche d’emploi les phases d’activité et de contemplation ont peu à peu été pensées sur le mode de l’opposition. Notre vie serait ainsi une succession d’époques régies par des lois singulières, étrangères l’une à l’autre, sans reprise (ce que Kierkegaard, au XIXe siècle, appelait « ressouvenir en avant ») ou réactivation de potentialités antérieurement développées. Aussi gardons nous rarement active en nous la puissance de l’enfance (Pascal Séverac) une fois atteint l’âge adulte. De même ne percevons nous pas les virtualités d’écoute sensible recelées par la vieillesse. Nous oublions enfin le fait que « les humains ne sont pas inclus dans leur “classe d’âge”, pas plus qu’ils ne peuvent être définitivement enclos dans une classe sociale, dans une communauté de lieu, de langue ou de temps historique. L’humain veut s’étendre, se distendre hors de son lieu d’appartenance originelle » [1]. « Etrange planète que chacun d’entre nous a été », disait en ce sens Henri Michaux. L’homme est un enfant qui a mis une vie à se restreindre, à se limiter, à s’éprouver, à se voir limité, à s’accepter limité. Adulte il y est parvenu, presque parvenu. L’Infini à tout homme, quoi qu’il veuille ou fasse, l’Infini, ça lui dit quelque chose, quelque chose de fondamental. Il en vient…» [2] Infini qui se sait toutefois relatif, toujours rapporté à la réalité de notre finitude, distinct de l’infini qui croit pouvoir échapper au fini en s’assignant pour but le dépassement incessant de nouvelles limites, laissant accroire que l’atteinte d’un idéal (celui de la réalisation d’objectifs de production toujours plus élevés) peut valoir comme norme[3].
Aussi, l’époque médiane de notre vie où nous combinons nos vies affectives, amoureuses, professionnelles, parentales, est-elle aujourd’hui devenue celle d’une vie intensive[4] souvent privée de l’intensité du sentiment de sa propre existence, comme anesthésiés par l’excès de notre charge de travail et le flux d’occupations en surnombre. Ce que l’on appelle «retraite», sortie de l’intégration sociale par le métier[4], y revêt le statut d’une réalité périphérique, au même titre que l’enfance, les expériences et les apprentissages de l’adolescence. Le vieillissement s’y trouve méprisé, la vieillesse transformée en objet de relégation. Cette vie dite « active » ignore la vie vulnérable ; elle est celle du clivage entre performance et défaillance ; elle est de plus en plus largement adhésion à la foi managériale, avatar contemporain de ce que Walter Benjamin appelait « la structure religieuse du capitalisme » en tant que « célébration d’un culte sans trêve et sans merci »[5] dont la concurrence constitue le maître-mot[6]. Or, dans cet horizon de concurrence entre les individus, et à l’intérieur de ceux-ci, entre le corps et l’esprit, le vieillissement des salariés est perçu comme loi de la nature faisant obstacle aux mouvements d’une économie fondée sur le principe d’une circulation des énergies où tout cadre protecteur donnant à voir la limite des possibilités de l’agir humain est devenu scandale. Les cas de harcèlement augmentent à l’approche de l’âge du départ à la retraite.
Sur le plan économique, la logique de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis le début des années 1970 incite au placement de l’épargne des salariés dans le capital des entreprises dont les profits sont censés garantir le versement d’une rente pour leur retraite avec à terme le risque que «la majeure partie de la population [fasse] pression pour maximiser les profits, et donc exploiter le travail» [7]. D’où l’idée de réformer conjointement le système des retraites (v. rapport de la Banque mondiale d’octobre 1994), le code du travail et le marché de l’emploi avec le choix du chômage comme variable d’ajustement structurel entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. Par conséquent, la question des retraites ne doit pas se limiter à celle de leur financement, ce dernier aspect ne relève pas de la pure contingence. Il procède d’une logique de refondation de la nature des rapports sociaux et du statut de l’individu dont la valeur se trouve appréciée à l’aune de sa capacité à prendre des risques[8]. Il pose également le problème de l’invisibilisation du rôle que continue et que continuera à jouer en la matière le travail, « activité vitale » (Marx) fondamentale à travers laquelle l’être humain prend conscience de ce qu’il est.
La construction d’une société où le travail est confondu avec l’emploi, réduit à une marchandise (Alain Supiot), et où l’individu est considéré comme étant le seul responsable de son destin transforme la retraite en espoir d’une vie meilleure ou en refuge aussi (en ce sens, prendre sa retraite signifierait aussi battre en retraite). La retraite semble de surcroît être une époque de notre vie où il devient possible d’échapper à la capture de notre temps et au préjudice occasionné par elle dont la pensée stoïcienne nous invite à nous prémunir : « Ton temps, dit Sénèque dans une lettre célèbre à son neveu Lucilius, jusqu’à présent, on te le prenait, on te le dérobait, il t’échappait. Récupère-le, et prends-en soin. La vérité, crois-moi, la voici : notre temps, on nous en arrache une partie, on nous en détourne une autre, et le reste nous coule entre les doigts. […] [Peux-tu] me citer un homme qui accorde du prix au temps, qui reconnaisse la valeur d’une journée, qui comprenne qu’il meurt chaque jour ? » Le temps de la mort est ainsi moins notre futur que notre présent, sur lequel nous renonçons inconsidérément à avoir prise. Le temps de la retraite, que Sénèque sut mettre à profit pour élaborer son œuvre philosophique, sera-t-il celui d’une vie meilleure au sens où il cessera de nous fuir entre les doigts ou de se laisser voler ? Ou bien sera-t-il celui du statu quo en dépit d’une plus grande liberté de disposer de son temps ? Ce qui reviendrait alors à dire que notre ancienne vie de travail colonise notre vie présente, l’aliène en transformant l’activité que nous y déployons en passivité, notre force en impuissance[9]. À moins que nous ne sachions apprendre à explorer le potentiel de désaliénation biographique, de déconditionnement de la subjectivité compétitive – avec l’injonction à canaliser ses désirs en vue de l’amélioration de son employabilité et de l’augmentation de sa vitalité – offert par notre retrait du système de production ou de compétition académique.
Le premier jour d’une vie porteuse de significations existentielles nouvelles, d’un mode d’investissement autre de la vie de la Cité (la vie de retraite n’est pas une vie retirée) débute alors. Notre vie et notre capacité à nous sentir vivants seront dès lors perçues comme étant notre seule richesse, elle-même devenue matière d’enseignement « d’une science de l’économie politique revue dans ses principes [, enseignant] aux nations à désirer et travailler pour les choses qui conduisent à la vie [et non au] pouvoir sur les hommes » [10] et à l’indifférence. Indifférence dont le refus de l’humanité de vivre obstinément pour la vie constitue le ferment comme sut le montrer le philosophe espagnol José Ortega Y Gasset au lendemain de la Première Guerre mondiale : « On a vécu pour la religion, pour la science, pour la morale, pour l’économie ; on a même vécu pour servir le fantôme de l’art et du plaisir ; on n’a juste jamais essayé de vivre délibérément pour la vie. Heureusement qu’on l’a toujours plus ou moins fait, mais non délibérément ; chaque fois que l’homme s’en est aperçu, il en a eu honte et a ressenti un étrange remords. Ce phénomène de l’histoire humaine est par trop surprenant pour ne pas mériter une méditation[11]. » Cependant, savoir vivre obstinément pour la vie suppose la prise de conscience préalable que dans toute pratique humaine « ce n’est pas la vie nue qui s’essaie en nous, mais des formes de vie. […] Chacun expose et explore dans ce qu’il fait non seulement l’être qu’il est, mais toute une manière d’être, libérant un possible humain : une image du vivant et de son insertion dans les choses, une façon de s’avancer au dehors et d’en soutenir l’effort, des modalités expressives et des façons de se conduire qui sont par définition partageables et généralisables [, que] Montaigne appelait la “ forme-maîtresse ” [d’une vie] » [12].
Or, ce désir de partage de formes et de styles de vie ne pourrait-il susciter aujourd’hui celui de la réinvention collective d’un horizon institutionnel et politique cloisonnant artificiellement les temps de notre vie, abolissant les continuités génératives qui existent entre eux, entre nos vies domestiques et professionnelles. Effort dont l’organisation serait celle de la fête d’une pensée amoureuse de la vie et d’une vie avide de pensée où les signifiants habituels (à commencer par celui de « retraite ») cesseraient d’avoir cours.
————–
Notes :
[1] Pierre Pachet, Le grand âge, Mazères, 1993 / 2018, p. 15.[2] Henri Michaux, Les Grandes Epreuves de l’esprit, Paris, Éditions Gallimard, 1966.
[3] Marie-Anne Dujarier, L’idéal au travail, Paris, PUF, 2006.
[4] Voir Tristan Garcia, La vie intense. Une obsession moderne, Paris, Éditions Autrement, 2016 ; Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, traduit de l’allemand par D. Renault., Paris, Éditions Autrement, 2011, 2013. »
[4] André Gorz, Le traître suivi du Vieillissement (1964), avec un avant-propos de Jean-Paul Sartre, Paris, 2004, 2008.
[5] Walter Benjamin, Le capitalisme comme religion et autres critiques de l’économie (1920-1939), traduit de l’allemand par Frédéric Joly, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2019.
[6] Pierre Dardot, Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, Éditions La Découverte, 2009, 2010.
[7] Pierre-Yves Gomez, Le travail invisible. Enquête sur une disparition, Paris, François Bourin, 2013.
[8] François Ewald et Denis Kessler, « Les noces du risque et de la politique », Le débat, mars-avril 2000, p. 54-72.
[9] Karl Marx, Manuscrits de 1844, traduction inédite de Jacques-Pierre Gougeon avec une introduction de Jean Salem, Paris, Éditions Garnier Flammarion, 1999.
[10] John Ruskin, Il n’y a de richesse que la vie (essais, 1860), traduit de l’anglais par Pierre Thiesset et Quentin Thomasset, Vierzon, Éditions Le pas de côté, 2012, p. 101 et 48.
[11] José Ortega y Gasset, Le thème de notre temps, présenté et traduit de l’espagnol par David Uzal, Paris, Les Belles Lettres (coll. « Bibliothèque classique de la liberté »), 2019, p. 78
[12] Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être, Paris, Éditions Gallimard (coll. Essais), 2011.
Via le site http://blog.cnam.fr



![[CINÉ-DOCUMENTAIRE] « Sauve qui peut ». Sauver l’hôpital ou sauver sa peau ?](https://www.souffrance-et-travail.com/wp-content/uploads/2025/06/hopital-docu-sauve-qui-peut-400x250.jpg)