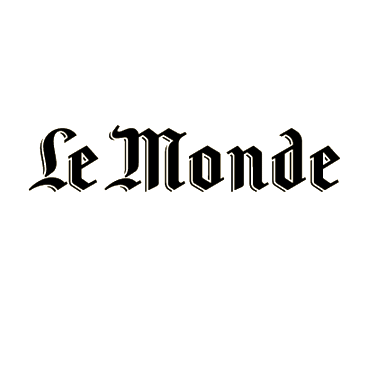En relaxant une femme pauvre en 1898, Paul Magnaud invente l’« état de nécessité » : n’est pas pénalement responsable celui qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, accomplit un acte défendu par la loi.
Le « bon juge » Magnaud est « né » le 4 mars 1898. Il avait 50 ans, des cheveux blancs, portait moustache et barbe bien taillées aussi brun sombre que ses yeux. Ce vendredi-là, comme chaque jour depuis onze ans qu’il présidait le tribunal correctionnel de Château-Thierry, dans l’Aisne, Paul Magnaud avait enfilé sa culotte à fourche de cuir et sa veste à ceinture, chaussé ses guêtres jaunes, coiffé sa tête d’une drôle de casquette de cycliste et enfourché son cheval pour rejoindre le palais de justice en longeant la Marne par le chemin de halage. L’audience s’annonçait peu chargée. Rien que de l’ordinaire : deux délits de braconnage, un outrage à garde-chasse par un homme aviné et une petite affaire de vol dans une boulangerie. Les débats furent vite expédiés, quatre et deux mois de prison pour les braconniers, quinze jours avec sursis pour l’ivrogne indélicat. Restait l’affaire de la voleuse. Montant du larcin : un pain de six livres.
Louise Ménard est appelée à la barre. Elle a 22 ans, élève seule son petit garçon de deux ans et partage avec sa mère, qui est veuve, le bon d’alimentation hebdomadaire – deux kilos de pain, deux livres de viande – accordé par le bureau de bienfaisance de sa bourgade. Le 22 février, explique-t-elle, les deux femmes et l’enfant n’avaient pas mangé depuis trente-six heures, lorsqu’elle est entrée dans la boulangerie de son cousin Pierre pour y dérober un pain. Le cousin confirme sa plainte. Entendus à leur tour, les gendarmes rapportent que lorsqu’ils sont arrivés chez Louise Ménard, la miche était dévorée aux trois quarts. Le procureur Vialatte demande la condamnation de la voleuse. Le tribunal se retire pour délibérer. Une heure, deux peut-être, passent.
Le président Magnaud rend son jugement :
« Attendu qu’il est regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute. Que, lorsqu’une pareille situation se présente, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d’amoindrir en lui la notion du bien et du mal. Qu’un acte, ordinairement répréhensible, perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité. (…) Que l’irresponsabilité doit être admise en faveur de ceux qui n’ont agi que sous l’irrésistible impulsion de la faim. Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, sans dépens. »
Louise Ménard est relaxée. Alors qu’elle s’apprête à quitter la salle d’audience, le greffier lui murmure que le président Magnaud souhaite la voir dans son cabinet. En la saluant, il lui glisse une pièce d’argent de cinq francs dans la main.
Le nom de Louise Ménard vient d’entrer dans l’histoire du droit, accolé à celui du juge de Château-Thierry qui a inventé pour elle « l’état de nécessité » : n’est pas pénalement responsable celui qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, accomplit un acte défendu par la loi. Dès le lendemain, le jugement de Magnaud est publié en première page du quotidien radical L’Avenir de l’Aisne. Quelques jours plus tard, la presse nationale s’empare de l’affaire. Le 14 mars, L’Aurore publie à la une un court billet sous le titre « Un bon juge ». Il est signé Georges Clemenceau. Les lecteurs s’émeuvent, une souscription est lancée en faveur de Louise Ménard. Le photographe Nadar envoie quarante francs, la princesse de Rohan en adresse cinquante. Aux hommages adressés au juge Magnaud par Courteline et la journaliste Séverine se mêlent des mots d’anonymes. « Je suis sûr que si le grand Victor Hugo était encore de ce monde, il se fût déplacé pour vous serrer la main », lui écrit un lecteur parisien.
Nouvelle popularité
Un an plus tard, le juge Magnaud récidive. Chiabrando, 17 ans, a quitté son travail et l’hospice qui l’accueillait, il est d’origine étrangère, traîne sur les routes et a déjà été condamné pour mendicité, lorsqu’il est présenté devant le tribunal de Château-Thierry pour avoir quémandé – et obtenu – un morceau de pain à La Ferté-Millon (Aisne), le 22 décembre 1898. Les instructions du garde des sceaux sont claires contre ces vagabonds qui font peur aux braves gens.
Paul Magnaud, auréolé de sa nouvelle popularité, décide de défier sa hiérarchie. Non seulement il prononce la relaxe du jeune homme, mais il saisit l’occasion pour dire tout le mal qu’il pense d’une loi trop rigoureuse.
« Attendu que la société, dont le premier devoir est de venir en aide à ceux de ses membres réellement malheureux, est particulièrement mal venue à requérir contre l’un d’eux », il appelle tout juge à « oublier, pour un instant, le bien-être dont il jouit généralement afin de s’identifier, autant que possible, avec la situation lamentable de l’être abandonné de tous qui, en haillons, sans argent, exposé à toutes les intempéries, court les routes et ne parvient le plus souvent qu’à éveiller la défiance de ceux auxquels il s’adresse pour obtenir quelque travail. »
Le parquet, furieux, fait appel, la Chambre des députés s’enflamme. L’avocat et député socialiste René Viviani annonce qu’il viendra lui-même défendre le vagabond devant la cour d’appel. Cinq mois plus tard, le garde des sceaux rédige une circulaire dans laquelle il reprend, sans le citer, plusieurs des arguments de Paul Magnaud, en demandant aux magistrats du parquet de « mûrement réfléchir » avant de renvoyer devant le tribunal des mendiants ou des vagabonds et de ne le faire que lorsqu’ils ont acquis la conviction « qu’ils sont en présence d’un incorrigible et invétéré fainéant ». Il faudra attendre soixante-dix ans pour que les délits de mendicité et de vagabondage soient abolis.
…
Lire la site (payant) sur le site www.lemonde.fr