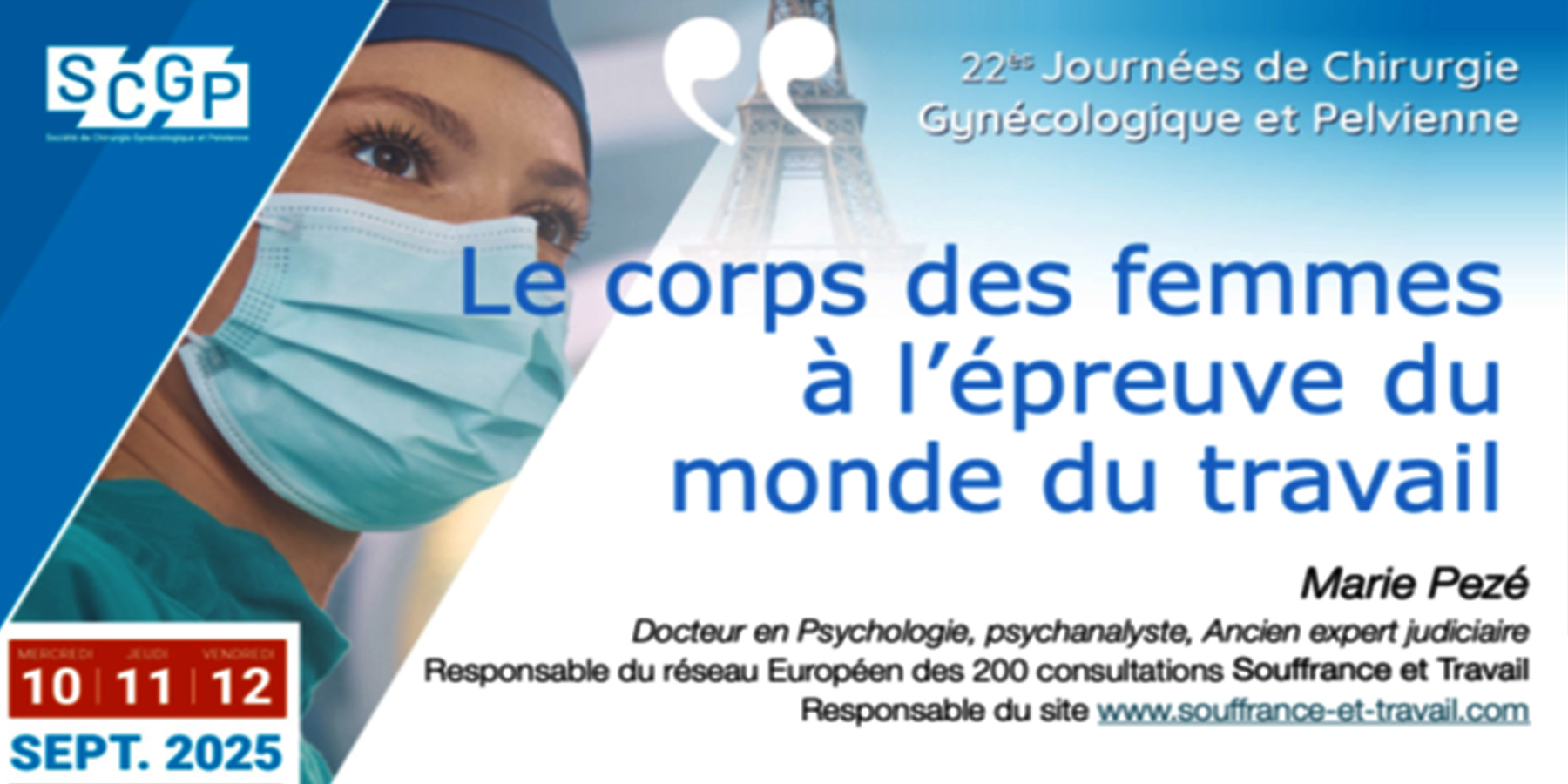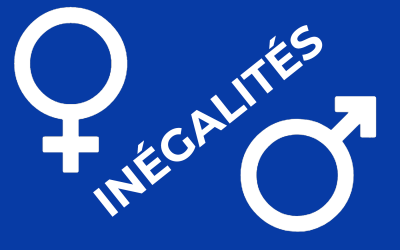Conférence de Marie Pezé les 10, 11 et 12 septembre 2025 aux 22e Journées de Chirurgie gynécologique et pelvienne.
Les soignants que l’on a ponctuellement applaudis à nos fenêtres, évoquent depuis des années le manque d’effectifs, les flux tendus, les statuts précaires et l’épuisement devant les soins dégradés, l’intensification du travail, la perte de l’autonomie. L’injonction « au travail à tout prix pour sauver des vies » s’est déployée dans le manque de masques, d’EPI (équipements de protection individuelle), de matériels de ventilation, de kits et réactifs pour les tests diagnostic, de produits de sédation, de temps, de compétences, de perspectives sur la durée de l’investissement.
Le terreau du burn-out n’est pas tant la charge de travail que la perte de sens du soin et la souffrance éthique de mal faire son travail.
Si les soignants ont tenu, c’est aussi grâce aux retrouvailles avec le travail collectif, l’autonomie de décision, la mise au rebus temporaire du chiffrage constant de l’activité, le retour à l’inventivité, au sens du soin.
Le retour à une autonomie procédurale, au sens du travail a, comme par miracle, rendu leur énergie aux soignants épuisés, confirmant ce que disent les cliniciens du travail : le terreau du burn-out n’est pas tant la charge de travail que la perte de sens du soin et la souffrance éthique de mal faire son travail. Il faudrait tirer ces leçons de cette période inédite.
Il est à craindre que l’exemplaire construction collective que le monde des soignants a mis en œuvre ne se dissolve dans le retour frénétique au monde d’avant, celui des tableaux de bord, de la santé réduite aux algorithmes.
Le retour « à l’hôpital d’avant », s’il signifie la fin des héros du moment, est ressenti comme un abandon, un mensonge, voire une trahison. Or, celle-ci peut conduire à des effondrements psychiques ou physiques.
Le travail s’impose comme une donnée sociale qui participe, par ses formes d’organisation, à la construction ou à la déconstruction de la santé des corps et du psychisme.
C’est justement la construction de l’identité et du corps qui passionne la psychanalyste que je suis.
Le corps biologique, qu’on examine au microscope ;
Et le deuxième corps au travers duquel nous éprouvons la vie, la souffrance, le plaisir, le désir.
Le premier relève de l’inné. Le second, de l’acquis et de notre histoire infantile.
Votre corps dans l’organisation du travail est traité comme un moyen, pas comme une origine.
Malheureusement au travail, le corps n’est souvent considéré que comme un réservoir inaltérable de force, de puissance, d’énergie, un corps outil récapitulé par ses caractéristiques physiologiques. » Votre corps dans l’organisation du travail est traité comme un moyen, pas comme une origine.
A l’âge adulte, la construction identitaire va s’appuyer sur deux scènes majeures, le champ amoureux et le champ social et donc le travail. Travailler, c’est SE travailler. Travailler, c’est travailler ensemble.
Mais comment se contenter d’une approche purement psychanalytique ? Léger problème :
- Comment dire à l’aide-soignante qui douche 12 patients vite fait / mal fait / pas fait que son Œdipe y est pour quelque chose ?
- Comment dire à l’interne harcelée qui s’effondre à son poste : « Pourquoi n’êtes-vous pas partie plus tôt ? », de l’air entendu du psy qui pense que ce n’est pas normal de se faire humilier aussi longtemps, alors que démissionner fait perdre ses droits sociaux ?
- Toutes les femmes s’appuient-elles sur leur masochisme féminin pour accepter d’être payées 25 % de moins que les hommes ? Et sont-elles dans la revendication phallique quand elles réclament une augmentation ?
Penchons-nous sur la construction sociale même des métiers.
Les métiers, les positions sociales ont été occupés de tout temps d’abord par les hommes et donc édifiés à la mesure de leurs besoins, de leurs capacités musculaires, intellectuelles, cognitives.
La performance masculine n’est souvent obtenue que grâce au soutien du corps masculin par les femmes
Mais de façon cachée, grâce à ce que le corps des femmes a toujours épargné au corps des hommes. Car si les hommes ont pu investir le champ social avec tant de suprématie, c’est parce que les femmes les ont entièrement libérés de la charge du dedans, des enfants, du travail domestique, de la gestion de la santé – tâches encore trop invisibles qu’on peine à considérer comme un travail puisqu’elles sont supposées être accomplies gratuitement par amour.
La performance masculine n’est souvent obtenue que grâce au soutien du corps masculin par les femmes : Secrétaire aux petits soins, panseuse efficace et admirative, épouse dévouée épargnent le mari quant à la prise en charge du réel.
Habituées à s’occuper de la santé de tous, les femmes déploient au travail une meilleure résistance que les hommes, qui se traduit par une mortalité moindre. Elles se soignent. La maternité et l’éducation des enfants sont une charge mais aussi un socle identitaire précieux. Les Françaises semblent décidées à ne renoncer à aucune sphère de construction identitaire. Elles travaillent et font des enfants.
Dans une organisation du travail à la française qui organise des réunions tard le soir, donne les rapports à taper en fin de journée, entretient le culte de l’hyper présence virile comme modèle d’engagement dans l’entreprise, à contre-courant du modèle anglo-saxon où on part à 17 heures car rester au travail tard signe son incompétence. Bref, une organisation du travail faite pour l’étalon de référence, le corps masculin. Bien sûr, c’est une discrimination masquée, systémique, Celle qu’on ne peut pas faire bouger. Celle que personne n’arrive à voir.
Et c’est toujours en contre que le corps de la femme va devoir y trouver sa place.
Ce modèle organisationnel masculin n’est pas sans conséquence sur la santé des femmes au travail. C’est dans cette pathologie sans agression sexuelle objectivable, invisible, sans bourreaux ni victimes apparentes que je vous invite aujourd’hui à plonger.
En deçà des pathologies spécifiques et graves qu’elle peut engendrer, je m’attarderai sur les premiers signes infraliminaires qui viennent éroder, compromettre, gauchir, la construction de l’identité des femmes.
Par manque de références pour penser ce qui relève de l’extérieur, du champ social, chaque être humain rapatrie souvent la causalité de sa souffrance en intrapsychique. Si ça ne va pas, nous y sommes pour quelque chose. Et la psychologisation à outrance de notre société n’arrange rien. Une femme en difficulté au travail convoquera toujours SA responsabilité personnelle.
Une culpabilité première d’être femme.

La peur de Madame T :
Faire mieux avec moins…
Recrutée sur la base de son niveau universitaires, de ses qualités cliniques de chercheur, Madame T décrit un parcours professionnel satisfaisant au sein d’hôpitaux, publics et privés avant 1990. Elle y est autonome, sa hiérarchie directe lui fait confiance. Elle estime apprendre énormément. Aux entretiens d’embauches ou de mutations, les chefs de service lui ont cependant précisé, de façon subtile ou directe, qu’étant une femme, donc mère potentielle, elle n’aurait pas les mêmes primes que les hommes.
Au fils des années, et de l’introduction du new public management, l’ambiance de travail devient plus dure. Tous les 6 mois, une nouvelle organisation est mise en place pour pallier le manque d’effectifs. Faire mieux avec moins.
Elle n’a jamais le choix. Elle gère les services ou les essais que ses collègues masculins laissent.
Lorsque je travaillais à l’hôpital, je regardais les infirmières préparer les salles de consultations. Pour les médecins hommes, elles sont là, ouvrent les dossiers, s’activent.
Pour les médecins femmes, la salle est préparée, mais les dossiers sont posés sur le bureau. Qu’elles se débrouillent.
Du coup, les femmes médecins, les chirurgiennes au bloc opératoire, doivent veiller très attentivement à la manière dont elles formulent leurs demandes. D’ailleurs, la pile de dossiers non ouverts sur le bureau est signifiante : « Tu te débrouilles, je ne te sers pas ». [1]
Ne voient-elles pas qu’elles perpétuent la discrimination de système qui pèse déjà sur elles en tant que femmes ?
S’occuper des médecins hommes rapporte en termes de construction de la féminité, pas s’occuper des femmes. En termes de rivalité, il est plus facile d’obéir à un homme qu’à une autre femme.
Décharger le corps des médecins et des chirurgiens de la paperasse, de l’ordinaire du travail, admirer la conduite de l’examen, le diagnostic posé, le soin technique, bref la partie du travail la plus sophistiquée, c’est cela la fonction de l’infirmière de consultation. Mais ce travail ne sert à construire l’identité féminine que s’il dégage l’or du travail du médecin homme. Pas d’une autre femme. Qu’elle se débrouille…
Bien sûr, c’est une discrimination masquée, systémique.
Celle qu’on ne peut pas faire bouger. Celle que personne n’arrive à voir.
C’est parce que t’as baisé avec le patron !
Lorsque madame T est nommée directrice d’une unité, sur la base de nombreuses publications internationales et sur sa capacité à lever des fonds pour les recherches, Les hommes de son entourage lui glissent :« C’est parce que t’as baisé avec le patron ! ».
A partir de sa nomination, on lui demande de s’affirmer, d’avoir un profil d’autorité. S’affirmer sur quelqu’un consiste à « mettre la pression » sur un inférieur hiérarchique, lui donner des objectifs irréalisables, sans moyen et en peu de temps et de lui dire que c’est un challenge. Mettre aussi la pression dès que les gens rentrent de vacances. Affirmer son autorité sur les autres passe par ce type de relations « viriles » alors que « mon concept de l’autorité en tant que femme, passe par la relation », précise la patiente. « Par la coopération, par la prise en considération de l’autre, de ses compétences professionnelles ».
Comme beaucoup de femmes cadres, elle s’aligne sur une sorte de norme au masculin neutre. Pour être apprécié, un cadre, un vrai, doit parvenir à une dureté morale devenue, dans le monde du travail, un équivalent de courage, de force de caractère. Mais lorsque madame T élève la voix, on lui reproche sa voix de crécelle, sa virulence, l’agressivité de ses propos. Nul doute que, si elle était un homme, ses interventions seraient simplement qualifiées de « trop musclées ».
Au travail, elle ne porte plus de jupe, mais des tailleurs pantalons. Elle a réduit son maquillage au « minimum social ».
Lorsque les femmes participent à des réunions, elles doivent encore lutter pour accéder à la parole, retenir l’attention. Le déni exercé les oblige souvent à recourir à l’arme classique, l’éclat vocal, aussi rebaptisé « exhibition hystérique » « cris de harpie caractérielle ».
Si elle n’arrive pas à gérer toutes ces contradictions, c’est de SA faute.
Comment les femmes pourraient-elles, seules, sans les catégories de pensée adéquates, sans un vrai travail de déconstruction, sans notre aide, percevoir ce qui relève d’une discrimination de système dans le sort qui leur est réservé au travail et ce qui relèverait de leur psychisme personnel ?
Comment construire son identité au travail en tant que femme si cela induit des comportements masculins compliqués à affronter ?
S’affirmer mais gentiment
Réclamer mais avec le sourire
Imposer par la conviction
Donner des ordres mais sans s’imposer
Être gentille mais pas trop
Sourire mais sans séduire
Être coquette sans allumer
Être à l’écoute sans créer trop d’intimité
Penser au menu du soir tout en conduisant la réunion
Prendre les RDV chez le pédiatre ou le dentiste tout en terminant le dossier en cours
Pour moins « provoquer » de réflexions et là, lorsque j’utilise ce verbe, vous mesurez déjà la mise en place d’une position féminine fautive… Depuis la nuit des temps, c’est à la femme, dans tous les pays, sous des formes multiples, de porter la culpabilité de l’effet qu’elle fait aux hommes.
Pour moins provoquer, donc, Madame T a réprimé les signes trop sociaux de sa féminité. Gommer en partie son identité pour se protéger, est-ce vraiment sur le long terme une protection ? La solitude des femmes au travail peut ainsi devenir majeure et constituer la cause première de l’apparition des symptômes.
A qui les femmes peuvent elles se confier ? Au mari, à la famille ? Le salaire de la femme est nécessaire pour éponger les emprunts, financer la garde des enfants. Encore plus si on est en situation de monoparentalité.
Au travail, la fatigue de tous est irrecevable au travail. La verbaliser publiquement implique de se déterminer, de faire un choix, de renoncer : travail ou enfants.
Alors les femmes pleurent dans les toilettes quand elles n’en peuvent plus. Leur usure physique et mentale s’accroit mais elles passent outre. Puis, elles ne la perçoivent plus.
Détecter ces signes d’alerte est quasi impossible par l’environnement de travail, si tant est qu’il s’en préoccupe, ou par l’environnement familial lui-même pris dans la surcharge de travail.
« L’envie de pleurer est là. J’ai la forte sensation d’être en danger, je n’ai plus de forces, plus envie de manger et parfois des idées suicidaires ».
Madame T.
Madame T est épuisée, ne pèse plus que 48 kg. On ne l’informe plus des réunions. Elle est mise en invisibilité, exclue par un boycott souterrain qui va de soi.
Elle se sent défaillante, insuffisante, impuissante. Elle décide de demander un temps partiel car la surcharge chronique de travail a laissé des traces dans sa vie privée. Ses deux enfants ont des difficultés. Elle est convoquée par son D.R.H. qui lui souligne qu’elle est la première à réclamer, cela ne doit pas se savoir, qu’il « n’a pas à gérer en plus les hormones de ces dames ». La non-convergence dans les pratiques sociales des hommes et des femmes sur le temps hors travail, devient caricaturale autour de la demande de temps partiel. La demande est incompréhensible pour son chef qui lui fait désormais des réflexions quotidiennes.
La décompensation est là, majeure sur le versant de l’épuisement professionnel mais sans cesse combattue pour tenir au travail et ne pas couler. L’état général s’aggrave. Le phénomène physique commence toujours par des vertiges : « l’envie de pleurer est là. J’ai la forte sensation d’être en danger, je n’ai plus de forces, plus envie de manger et parfois des idées suicidaires ».
A son retour de vacances, en septembre, elle est sur un nouvel essai clinique dans un autre département, seule femme dans un collectif d’hommes. Madame T doit gérer psychiquement cette contradiction : supporter des images de vulve en gros plan sur les écrans de veille de ses collègues et demeurer leur médiatrice compréhensive.
Le chef du département vient lui parler en se collant à elle et en lui parlant à 25 cm de sa bouche. « Cet homme qui me colle quand il parle, c’est l’horreur tellement il sent mauvais. A plusieurs reprises, je me pousse mais il se rapproche à nouveau. Il sent mauvais, il est grossier, il n’écoute pas. Je lui fais remarquer que je ne suis pas sourde, que je souhaite plus de distance entre nous. » Son chef de service à qui elle va se plaindre des écrans pornographiques et de la gestuelle déplacée du chef de mission, lui répond : « Ça a toujours été comme ça et je ne peux rien changer ».
En parallèle, le règlement stipule qu’on n’y pratique aucune discrimination à l’égard des employés que ce soit en raison de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur sexe qu’on s’engage à les traiter avec dignité et en respectant pleinement leur vie privée.
Madame T raconte qu’elle ne s’exprime pas, ne pleure pas, ne parle plus à ses collègues ou à son entourage. Par manque de références pour penser ce qui relève du champ social, elle rapatrie la causalité en intrapsychique. Elle pense sa souffrance en termes de responsabilité personnelle. Tous les soirs, elle rentre usée, humiliée, abîmée, isolée. Si elle répond, elle est génératrice de conflit, si elle ne réagit pas, elle s’en veut d’être lâche. La honte se surajoute au tableau.
Elle réagit aux tentatives de déstabilisation, au mépris insidieux, par une hypervigilance, un surinvestissement de la qualité de son travail, supposées permettre l’évitement des critiques et des brimades Cet activisme est défensif. Être dans le faire pour ne pas penser.
La fatigue, L’anxiété, les troubles du sommeil, l’isolement, l’augmentation de prise de médicaments ou de différents produits (addictions), sont peu visibles.
Elle ne prend plus le temps de déjeuner, rentre de plus en plus tard le soir pour boucler son travail. Tous les week-ends, elle est couchée avec des maux de tête ou de ventre. Elle n’a plus le temps ni la force de s’occuper de ses enfants. La peur ne la quitte plus. Le jour, Elle revoit en boucle les scènes de critiques, La nuit elle fait des cauchemars intrusifs qui la réveillent en sueur. Bientôt, elle n’arrive plus à dormir.
Comme madame T, la plupart des femmes sont dans un Isolement de fait lorsqu’elles sont sur des postes sans équipe, dans un isolement subjectif lorsqu’elles sont seule femme dans un collectif masculin, ou sur un poste où le collectif de travail n’existe pas vraiment, où la coopération est morte à fortiori la solidarité. Ou bien avec d’autres femmes qui ont peur, honte elles aussi et qui surtout ne savent pas comment réagir.
Tenir au travail renvoie alors le sujet à ses seuls ressources individuelles, le privant de l’appui du collectif. Il peut même s’y heurter et devenir le bouc émissaire.
Elle me dit soudain qu’une aménorrhée s’est installée.
Le processus de construction de l’identité sexuelle part du corps, il vient s’y éteindre.
Elle retrouve la date dans son dossier médical : 1995. Nous voilà renvoyé à la période de radicalisation dans l’organisation du travail, sur l’attaque systématique du féminin.
Chez de nombreuses femmes en situation de harcèlement et/ou d’épuisement, l’anamnèse permet de retrouver des atteintes de la sphère gynécologique : aménorrhées, métrorragies, difficultés pour tomber enceinte, parcours de PMA à caser dans l’emploi du temps plus graves encore, cancers du col, de l’ovaire, de l’utérus. Chez Madame T. la mise en invisibilité de son identité féminine, l’attaque quotidienne de ses caractéristiques physiques, psychologiques, de ses compétences professionnelles, ont entraîné une lente et inexorable désintrication pulsionnelle. Le processus de construction de l’identité sexuelle part du corps, il vient s’y éteindre.
La disparition de ses règles signe le harcèlement de genre à un niveau somatique, A la virilité affichée par le vocabulaire agressif et juteux, la gestuelle intrusive, les comportements musclés, les écrans de veille porno qui viennent solliciter l’économie érotique masculine dans ses pulsions partielles, Madame T. semble répondre par la neutralisation de son identité sexuée jusqu’au niveau somatique.
Le stress au travail des femmes est étudié aux USA, au Japon, par des cardiologues qui débouchent sur les mêmes critères de survenue
- plus de 70 heures de travail par semaine,
- des changements constants,
- un effort supplémentaire avant l’épisode électrique dont la sémiologie est enseignée à partir des symptômes masculins.
Le stress au travail entraine aussi l’augmentation des diabètes à travers deux phénomènes : perturbations du système neuroendocrinien et immunitaire débouchant sur la production accrue des hormones telles que le cortisol et l’adrénaline, et changements de comportements alimentaires et de dépenses d’énergie, peut-être en guise de compensation.
Les méthodes gestionnaires prétendent qu’on peut même à terme se passer de ces corps de travailleurs. Automates, machines, exosquelettes, process, intelligence artificielle, systèmes experts… Si la vitalité de l’Homme au travail se trouve aujourd’hui sollicitée au moyen d’artifices pharmacologiques et idéologiques, ses principes reposent sur la négation du corps.
Devant la puissance du « big data », des tableaux de bord, des algorithmes, Il faut continuer à croire à la force des pulsions de vie ; à la possibilité, plutôt que se suicider ou tomber malade, de partir sans se retourner.
Croire à la puissance du travail réel qui fait tenir le monde.
Marie Pezé, septembre 2025
[1] Pascale Molinier, L’Énigme de la femme active, Payot, 2003.