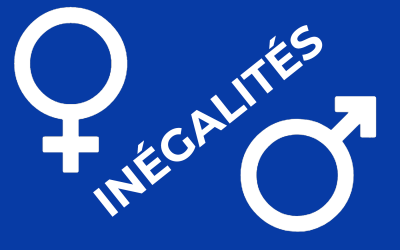Quand elle a appris qu’elle devait arrêter de travailler, Béatrice Boulanger, aide à domicile, en a pleuré : « Je les aimais bien, mes mamies et mes papys », explique-t-elle en souriant.
Elle souffre d’une prothèse d’épaule, de l’omarthrose (usure du cartilage de l’articulation de l’épaule), d’un rétrécissement du rachis cervical, de l’arthrose cervicale et d’une rhizarthrose (arthrose de la base du pouce). « Tous mes problèmes de santé viennent des charges que j’ai dû soulever, c’est le chirurgien qui me l’a dit. » Le praticien lui a également confié qu’elle avait « un corps de vieillard », à 52 ans.
Après avoir fabriqué à la chaîne des pantalons pendant dix ans, Béatrice Boulanger s’est rendue plusieurs fois par jour chez des personnes âgées, parfois gravement malades, pour les aider à se lever, à faire leur toilette, à se préparer à manger, à aller se coucher. « J’ai tout appris sur le tas, sans formation. Je me suis occupée de beaucoup de cas lourds, c’est là que je me suis foutu l’épaule en l’air. » En février 2015, alors qu’elle soulevait une vieille dame pour l’aider à sortir de la baignoire, « ça a craqué, » raconte-t-elle. « Tout s’émiettait autour. Les médecins ont dû couper la tête d’épaule ».
Comme Béatrice Boulanger, de plus en plus de femmes sont victimes d’accidents du travail.
D’après l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), « si les accidents du travail avec arrêt baissent globalement de 15,3 % entre 2001 et 2015, ils progressent pour les femmes. Sur cette période, ils ont augmenté de 28 % pour [celles-ci] tandis qu’ils ont baissé de 28,6 % pour les hommes ». Ce spectaculaire écart s’explique en partie par les évolutions de l’emploi en France : d’un côté, les emplois industriels, traditionnellement les plus dangereux et masculins, disparaissent ; de l’autre, les femmes ont fait une entrée massive sur le marché du travail, dans des secteurs à dominante féminine dont les difficultés sont moins reconnues.
L’histoire de la santé au travail fournit aussi une autre explication. Car, construite dans des branches comme le bâtiment, la chimie ou la métallurgie, la notion de pénibilité s’est d’abord définie en fonction de critères masculins.
« Les recherches ne sont quasiment jamais faites dans une perspective de genre, » constatait le Conseil économique, social et environnemental (CESE) en 2010. « L’impact des facteurs de risques au travail sur la santé des femmes conserve ainsi à bien des égards un caractère d’invisibilité entraînant méconnaissance ou sous-estimation et donc faible prise en prise en compte ».
Lancé en 2015, le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) en donnait l’illustration. À l’époque, il recensait dix facteurs de pénibilité — activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, etc. — en fonction desquels les salariés se voyaient attribuer des points selon leur degré d’exposition.
Ce décompte leur permettait ensuite de financer un passage à temps partiel, de partir à la retraite de façon anticipée ou encore de suivre des formations.
Quatre de ces critères — manutentions manuelles de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques et risques chimiques — ont depuis été supprimés par le gouvernement du Président Emmanuel Macron lors de la réforme du code du travail, et le compte personnel de prévention de la pénibilité est devenu le compte professionnel de prévention (C2P).
Mais le problème reste le même. En 2017 comme en 2015, parmi les critères retenus, un seul concerne une proportion plus importante de femmes que d’hommes : le travail répétitif, une réalité qui touche 9,2 % des femmes salariées, contre 7,6 % des hommes salariés. Pour les autres, la barre demeure souvent trop haute pour que les femmes voient la pénibilité de leur travail reconnue.
Maladies professionnelles invisibles
L’exemple des hôtesses de caisse est éclairant. Même si ces employées scannent environ une tonne de marchandises par heure, elles n’accédaient pas à la reconnaissance du port de charges lourdes (selon les critères définis en 2015), à savoir lever ou porter quinze kilogrammes au moins six cents heures par an. Pourquoi ? Parce que la fréquence des temps partiels chez les femmes (tout particulièrement dans ce métier) et le mode de calcul de la pénibilité (en charge unitaire plutôt qu’en poids cumulé) ne leur permettaient pas d’atteindre le seuil requis. Ces salariées passaient ainsi en dessous du radar des critères de la pénibilité.
Celles-ci restent d’ailleurs tout aussi invisibles en ce qui concerne les maladies professionnelles.
Ainsi, explique la psychanalyste Marie Pezé, spécialiste de la souffrance au travail, « les caissières souffrent généralement d’un étirement du plexus brachial, une racine nerveuse bien implantée dans le corps [entre le cou et l’aisselle]. Or cette maladie n’est pas recensée dans le tableau 57 des maladies professionnelles ».
L’histoire de ce tableau, tardif et encore incomplet, illustre bien les obstacles à la reconnaissance de la pénibilité du travail au féminin. Créée en 1972, cette liste de pathologies recense les troubles musculo-squelettiques (TMS), des affections provoquées par des efforts de faible intensité mais répétitifs, auxquelles les femmes sont particulièrement exposées.
Décelés dès le début du XVIIIe siècle chez les boulangers, les tisserands et les copistes par le professeur de médecine italien Bernardino Ramazzini, ces troubles sont repérés au cours du XIXe siècle chez les blanchisseuses et les couturières.
Puis, en 1955, certaines de ces lésions sont indemnisées pour la première fois : celles provoquées par le maniement de marteaux pneumatiques et d’outils vibrants — dans le cadre de travaux masculins. Si les médecins du travail et l’administration mettent en lumière de nouvelles professions à risques (mineur, dactylographe, ouvrier ou ouvrière à la chaîne, personnel des abattoirs et conserveries), « reste que la mobilité d’une partie des salariés affectés à des tâches répétitives, femmes et immigrés notamment, facilite l’occultation des problèmes », note Nicolas Hatzfeld, maître de conférences à l’université d’Évry.
Il a fallu attendre près de vingt ans pour voir les TMS pleinement reconnus : d’abord pour l’hygroma du genou que contractent des ouvriers du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), puis d’année en année pour les tendinites, la compression de nerfs, le coude, le poignet, la main, etc., qui touchent les emplois féminins.
Derrière le grand bureau de son cabinet parisien, l’avocate Rachel Saada, spécialiste en droit du travail, souligne les ambiguïtés de cette reconnaissance, tant pour les hommes que pour les femmes. « La question de la pénibilité est venue brouiller les pistes », estime-t-elle. « C’est une bataille de mots pour atténuer la souffrance et prétendre qu’on fait ce qu’il faut pour éradiquer les dégâts causés par une organisation du travail délétère. »
…
Lire la suite sur le site equaltimes.org