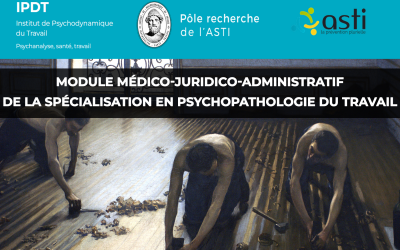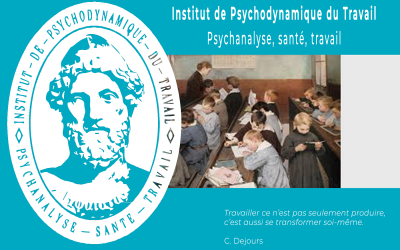Pour convertir de studieux élèves de classe préparatoire et d’université en manageurs, les grandes écoles de commerce institutionnalisent un mépris pour la curiosité. Les étudiants perdent progressivement leur goût du savoir pour se plier aux injonctions de la vie de l’établissement. Délestés de leur souci scolaire, ils peuvent alors s’accommoder du « sérieux » du monde de l’entreprise.
Une fois diplômé, en 2016, de Grenoble École de management (GEM), une école de commerce française réputée, M. Étienne Badaroux, 25 ans, part faire le tour des Balkans avec des camarades de promotion à bord d’une vieille fourgonnette Peugeot, modèle J5. À son retour en France, après dix mois de voyage, le jeune homme a pris une décision irrévocable : « Je me suis dit que plus jamais je ne bosserais en costard de ma vie. » Depuis l’été 2017, il enchaîne les expériences en tant que barman. Et le zinc lui sied bien mieux que les bureaux qu’il a pu occuper au cours de ses expériences en entreprise.
Ce jeune homme dépeint un malaise existentiel qui dépasse le champ vestimentaire : « On nous a répété : “La prépa, c’est la voie royale.” Mais la voie royale vers quoi ? À quoi sert d’apprendre des théories d’économie et de philosophie pour ensuite passer sa vie à vendre un produit en comptant les centimes que l’on peut gagner sur chaque exemplaire ? Ça n’a pas de sens. »
Avant d’intégrer GEM, M. Badaroux est passé par une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce — les fameuses prépas HEC, qui attirent environ vingt mille élèves chaque année, un chiffre stable depuis dix ans. Dans ces classes, les étudiants jonglent avec des concepts de philosophie, d’économie, de mathématiques, réfléchissent aux problèmes géopolitiques du Proche-Orient et dissertent sur les ressorts ontologiques du plaisir ou de l’espace. Bref, un lieu où le savoir universitaire est roi.
À l’issue de deux années marquées par une grande intensité de travail, ils passent un concours national. Selon leur classement et leurs vœux, ils sont admis dans l’une des vingt-six grandes écoles de commerce qui recrutent des étudiants à partir du niveau bac + 2. Ces prestigieux établissements forment les futurs cadres de l’économie et se distinguent des dizaines d’autres qui portent aussi le nom d’« écoles de commerce » ou d’« écoles de management » (appellation adoptée par les grandes écoles de commerce) mais n’offrent pas le même niveau de débouchés et ne sont pas reconnus par l’État. Ils ont des budgets importants, financés à plus de 50 % par d’onéreux frais de scolarité (12 080 euros par an en moyenne à la rentrée 2018), auxquels s’ajoutent la taxe d’apprentissage, les subventions des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et, de plus en plus, des capitaux privés.
Rares sont les diplômés à avoir, comme M. Badaroux, renoncé à une carrière toute tracée dans la finance, le conseil ou le marketing, avec le salaire qui l’accompagne : environ 35 000 euros brut par an à la sortie de l’école. Toutefois, le désenchantement qu’il décrit est loin d’être exceptionnel. Ce malaise apparaît surtout la première année, devant la faiblesse de l’exigence intellectuelle des enseignements. Lors des premiers cours de marketing ou de management des organisations, les étudiants sont souvent dépités. Ancienne élève d’Audencia Business School, à Nantes, Mme Catherine Galtier se souvient des « évidences théorisées », une façon, pour elle, de désigner la propension des livres de management à conceptualiser des notions qui relèvent du bon sens. Cette sorte d’infantilisation intellectuelle semble également présente dans le discours du corps enseignant : « Les intervenants ne se rendent même pas compte du vide que l’on ressent. On a l’impression de brasser du vent dans de nombreux cours. »
Une « expérience commune forte »
« Les cours, je ne suis pas sûre qu’on s’en serve, lâche de son côté Mme Albane Meteyer, qui, après un brevet de technicien supérieur (BTS) de communication, en 2014, a intégré Skema Business School, sur le campus de Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes). Tu paies pour l’école, pas pour le contenu des cours. »
Même si ce malaise a largement tendance à se dissiper au fil de la scolarité, il préfigure ce que le sociologue et économiste Yves-Marie Abraham a qualifié, à la suite d’une enquête sur l’École des hautes études commerciales (HEC), de « déscolarisation en milieu scolaire (1) ». Cette « neutralisation du jeu scolaire », observe-t-il, apparaît comme une condition nécessaire de la formation : les étudiants de HEC ne deviendront de bons manageurs que « dans la mesure où ils auront cessé d’être de bons étudiants ». Directrice du programme grande école de Skema Business School, Mme Sophie Gay éclaire la thèse du chercheur : « Il y a une rupture forte entre la prépa et l’école. Les objectifs sont très différents. Notre formation est tournée vers l’action, même si elle nécessite un socle réflexif. »
Les bons résultats scolaires n’influencent qu’à la marge le projet professionnel de ces futurs manageurs. Le classement des élèves au sein de leur promotion détermine deux choses : leur destination pour le semestre qu’ils doivent passer dans une université étrangère et le choix de leur spécialisation (ou « majeure »), qui ne sont que des « à-côtés » du diplôme, selon Abraham. « La réussite scolaire, ce n’est pas la note, précise Mme Gay. On parle plus de validation de compétences. L’important vient de l’ensemble du dispositif, des parcours individualisés et du réseau. »
Dans un jeu scolaire sans enjeu, le désengagement est inévitable ou presque. M. Quentin Pierrot, 26 ans, diplômé en 2016 de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) à Cergy-Pontoise, se souvient des salles de classe et des amphithéâtres où s’étendaient « des forêts de MacBook derrière lesquels tu te doutes bien que tout le monde n’est pas en train de prendre des notes ». Bien peu revendiquent une attitude sérieuse, d’autant que la réussite d’un partiel ne nécessite pas un travail approfondi : « En première année, en macro et en micro-économie, j’avais emprunté des livres de Sciences Po pour avoir d’autres éclairages, raconte Mme Brune Lange, elle aussi diplômée de l’Essec. Eh bien, je n’ai pas réussi mon partiel ! L’année suivante, j’ai simplement bossé sur des annales de partiels et appris bêtement les définitions du cours : je n’ai pas eu de problème. »
Dès le début de la scolarité prévaut la fameuse « vie de l’école », marquée par une obsession collective du ragot. Des associations « audiovisuelles » réunissent régulièrement les étudiants dans des amphithéâtres pour diffuser des séquences des soirées où sont étalés l’ivresse des uns et les baisers langoureux des autres, sans aucune forme de respect pour la pudeur ni la vie privée. Au-delà de la surconsommation d’alcool et de sordides histoires de bizutage, souvent dénoncées, le folklore actionne des ressorts affectifs chez des étudiants qui avaient auparavant mis leur vie sociale en suspens pendant deux ou trois années de classe préparatoire : week-end d’intégration, tournois de sport, soirées « bar à volonté », dégustations de vin, ski, croisières en voilier… « Avoir une expérience commune forte en première année est important, souligne M. Jean-François Fiorina, directeur adjoint de GEM. C’est ce qui permet un attachement à l’école, qui se perpétue des années après la fin de la formation. »
La « vie de l’école » permet de structurer les rapports sociaux, notamment grâce à un tissu associatif dense, qui participe d’un mouvement de hiérarchisation des étudiants. En 1999, le sociologue Gilles Lazuech relevait que « toutes les associations et tous les postes ne se valent pas (2) ». Il y a d’un côté les associations valorisantes, et de l’autre celles dont les membres sont d’une certaine façon déclassés. Le rayonnement de l’association est inversement proportionnel à son utilité publique. À l’École supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe, doyenne des écoles de commerce françaises), le Skloub, qui organise le voyage annuel au ski, est plébiscité. À l’inverse, les associations humanitaires n’occupent qu’une place marginale.
Lazuech mettait aussi en relief une division sexuée de l’espace associatif, les hommes obtenant la majorité des postes à responsabilité. Selon une étude du réseau d’associations étudiantes Animafac, en 2013, ils représentaient 59 % des présidents d’associations d’écoles de commerce. La division est également sociale : les élèves aux plus forts capitaux économiques, sociaux et culturels dominent le champ associatif. Ce qui faisait dire au sociologue que « les hiérarchisations internes qui caractérisent l’espace des activités extrascolaires » semblent avoir pour effet de « reproduire les grands principes de division et d’opposition qui structurent l’espace professionnel des cadres ».
Moins connu que le formatage idéologique et le credo néolibéral, le passage par une association est un maillon essentiel de la conversion au « sérieux managérial ». Car cette « institution dans l’institution » prépare les étudiants aux situations qu’ils connaîtront lorsqu’ils évolueront en entreprise, les amenant à développer aussi bien des compétences techniques que des savoir-faire utiles dans les relations interpersonnelles. Un poste de trésorier, par exemple, permet de se familiariser avec la comptabilité, mais aussi avec l’art de la négociation, notamment dans l’attribution des budgets aux pôles qui composent une association.
La conversion du souci scolaire en sérieux managérial, complétée par de nombreux stages en entreprise, révèle une ambiguïté intrinsèque aux business schools. Afin d’assurer leur place au sein de la famille des grandes écoles, celles-ci ont toujours été tiraillées entre la nécessité de dispenser une formation pratique, qui rend leurs diplômés directement opérationnels pour les entreprises, et un besoin de légitimité universitaire, notamment à travers le recrutement d’étudiants de classe préparatoire. Cette quête de légitimité passe aussi par la recherche en sciences de gestion, qui connaît une forte croissance depuis vingt ans.
Cette tendance répond à une logique de compétitivité accrue entre établissements en France et à l’étranger. Accordés l’un par une fondation européenne et l’autre par une organisation professionnelle américaine, les labels Equis (European Quality Improvement System) ou AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), labels importants et contraignants qui certifient l’excellence d’une formation, font la part belle à la recherche universitaire. Pour rémunérer des enseignants-chercheurs bien payés dans ces établissements (un jeune docteur gagne au minimum 50 000 euros brut par an), il faut trouver des financements auprès des entreprises… ou ponctionner les étudiants. Selon les chiffres fournis par les écoles, leurs frais de scolarité ont augmenté de 14 % ces trois dernières années. « Le tournant universitaire a joué un rôle essentiel dans la hausse de leurs besoins financiers, et leur investissement récent dans la recherche induit un renforcement certain dans l’ordre des priorités », explique la sociologue Marianne Blanchard (3). Et ce alors même que l’apport de la recherche à la qualité de l’enseignement semble loin d’être substantiel : « Les enseignants ayant une forte activité de recherche ne sont pas particulièrement appelés à en partager les résultats, poursuit Blanchard, ni à former les étudiants, ceux-ci étant vus comme essentiellement demandeurs d’une formation “pragmatique”. »
…
Lire la suite, Le diplômé, un « produit fini », sur le site www.monde-diplomatique.fr
———–