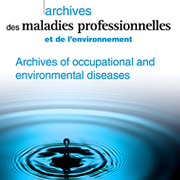C’est une histoire invisible comme il s’en déroule plus qu’on ne croit au sein des établissements scolaires. Mi-juin, une mère de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) se retrouve à la rue avec ses deux enfants, après deux mois éreintants passés à changer d’hôtel aux quatre coins de la région parisienne. Elle s’appelle Makoni, et elle a fui l’appartement familial, où son compagnon la tabassait depuis plusieurs années. Contrainte d’appeler le 115 pour subvenir à son hébergement, elle s’entend dire par le SAMU social, ce jour-là, qu’il n’y a « plus de place ». Hôtels et foyers affichent tous complet.
Pas le choix : une cage d’escalier de la cité des 4 000 servira de cambuse improvisée. Le lendemain, Makoni croise par hasard la directrice de l’école Paul-Langevin, où son fils et sa fille terminent leur CM1. Françoise Tirante prend des nouvelles de la jeune mère, dont elle connaît la situation précaire, et comprend illico que les choses ont empiré.
« Devant l’urgence, raconte l’enseignante, on a commencé à en parler avec quelques collègues. Et puis, très vite, l’une d’entre nous a proposé d’héberger les enfants chez elle. » Le conseil d’école est convoqué dans la foulée, et décision est prise de se cotiser pour payer une semaine d’hôtel à la famille. « On voulait qu’ils puissent se poser un peu », explique Françoise Tirante. « On les voyait tous les matins fatigués d’être trimballés à gauche et à droite. Ils n’en pouvaient plus », se souvient Maïté Gallois, l’institutrice du garçon, pour qui « laisser des enfants à la rue » est aussi « intolérable » que de les voir « perdre leur sourire ».
Intolérable, oui. De là à suppléer les organismes sociaux, le pas est grand cependant. Un enseignant a-t-il une autre mission que d’enseigner, c’est-à-dire transmettre des connaissances, dans ce sanctuaire qu’est l’école ? Héberger chez soi des élèves en grande difficulté fait-il partie du « job » ?
« Celui qui veut se contenter de son rôle d’enseignant ne doit pas venir travailler ici », tranche Françoise Tirante, qui est en poste depuis 1977 à La Courneuve. « Ici, poursuit-elle, on passe notre temps à résoudre des difficultés, à faire face à la précarité de nombreuses familles qui ont du mal à boucler les fins de mois. » C’est avec la même conviction d’être dans son rôle que la directrice a entamé les démarches administratives pour que les enfants de Makoni puissent partir en vacances, cet été, avec les services municipaux.
Autres ZEP, autres régions, autres niveaux scolaires… Mais une problématique identique. A la maternelle Henri-Wallon de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), la directrice Sylvie Lenoble consacre elle aussi une bonne portion de son énergie à démêler des noeuds et à régler des problèmes extrascolaires, autant d’activités « dont on me dit parfois qu’elles ne font pas partie de mon métier », soupire-t-elle. Le jour de la rentrée, elle passera deux heures à aider une maman à trouver un système de garde pour son enfant. Le soir même elle téléphonera encore à droite et à gauche afin d’aider un autre parent d’élève ayant perdu son emploi. Rien, bien sûr, ni circulaire ni directive, n’oblige Sylvie Lenoble à passer des coups de fil au-delà de 22 heures.
Comme rien n’oblige Olivier Gibergues, professeur des écoles en CP à Montpellier, à fournir des cartables à ses élèves, à la faveur d’un partenariat mis en place avec un fabricant du coin. A l’école du quartier Figuerolles, 70 des 130 enfants inscrits sont suivis par les services sociaux, et « 40 à 45 % des élèves ont des parents sans emploi », indique l’enseignant.
Appliquer mécaniquement le programme et ne pas tenir compte du contexte environnant est une aberration à laquelle Olivier Gibergues se refuse d’adhérer. C’est aussi pour cela qu’il a créé, dans sa classe, une séance de libération de la parole appelée « Quoi de neuf ? », et ne figurant dans aucun manuel. « C’est un moment où les enfants peuvent vider leur sac, mais aussi dire ce qui est positif, détaille-t-il. Ici, les problèmes ont besoin de sortir. Il arrive que, en plein cours, les gamins prennent la parole pour dire : « Cette nuit, j’ai été réveillé par le patron de maman qui frappait fort à la porte. » Ou : « J’ai mal dormi car il n’y avait pas de carreau à la fenêtre. » Ou encore : « Papa est rentré bourré. » » Parfois, Olivier Gibergues a « presque envie de faire semblant de ne pas avoir entendu » : « On ne peut évidemment pas laisser la classe comme ça. Il faut dédramatiser cette violence et aider les enfants à canaliser leur souffrance. Beaucoup viennent à l’école avec les problèmes de la maison. »
Quand ce ne sont pas les problèmes de… la terre entière. Dans le quartier populaire de la Rabaterie, à Saint-Pierre-des-Corps, le groupe scolaire Henri-Wallon a vu sa population se diversifier considérablement ces quinze dernières années, au fil des vagues d’immigration liées aux bouleversements internationaux. Conséquence : « Tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans les pays de l’Est, a des répercussions sur des quartiers comme le nôtre et donc sur l’école, indique Sylvie Lenoble, dont l’établissement compte une douzaine de nationalités. Les familles arrivent avec leurs histoires passées, les guerres qu’elles ont pu traverser, les horreurs parfois qu’elles ont pu vivre et une incertitude totale par rapport au lendemain. »
Afin d’anticiper les problèmes, l’école Henri-Wallon multiplie les rencontres, ateliers, discussions et autres goûters en dehors du temps scolaire. « L’informel compte énormément. Il permet de créer des contacts plus détendus avec les parents et de faire en sorte que ceux-ci se sentent accueillis. Pendant des années, j’ai beaucoup « travaillé » en faisant mes courses, en discutant avec les parents à côté du congélateur du supermarché », raconte la directrice. Après sa 33e rentrée sur place, elle se trouve des ressemblances avec « ces instits de campagne qui, autrefois, étaient totalement intégrés dans le village. Sauf que moi, c’est dans le quartier ». Si elle le pouvait, l’enseignante appliquerait ce souhait d’Albert Jacquard d’écrire au fronton de chaque école : « Ici, on enseigne la rencontre. »
Voire mieux : la solidarité, comme en ce matin de 2006 qui vit une famille du Kazakhstan, en attente d’une réponse à sa demande de droit d’asile, manquer de se faire expulser de son logement. L’école n’avait pas hésité à se mobiliser afin de lui éviter de dormir dehors. Un plâtrier turc avait même trouvé un emploi au père de famille. L’affaire, évidemment, avait fait débat au sein du milieu scolaire : jusqu’où l’école peut-elle aller face aux difficultés des parents d’élève ? Quelle distance le corps enseignant doit-il maintenir à l’égard d’enfants dont il a la responsabilité quatre jours par semaine ? Sylvie Lenoble, elle, avait reçu une lettre de son inspecteur de circonscription lui rappelant qu’elle n’avait pas à intervenir en pareil cas.
Un an plus tard, une autre histoire devait faire plus grand bruit encore, sur le plan national : le placement en garde à vue d’une institutrice parisienne qui s’était interposée entre des parents et des policiers lors de l’interpellation d’un ressortissant chinois (en situation irrégulière) venu chercher sa petite-fille à la sortie de l’école. Si aucune poursuite ne fut engagée contre elle, l’idée que des profs puissent revendiquer un « droit à s’engager » allait alors faire tache d’huile. Mais de manière peu concertée et relativement empirique, vu l’ampleur des champs d’intervention concernés. S’opposer juridiquement à une reconduite à la frontière, endosser le costume du travailleur social, combler les manques d’une mère absente ou d’un père violent ne sont pas choses qui s’improvisent.
« On n’a pas été formés à gérer ce type de situations, mais à appliquer le programme, point barre ! », déplore Olivier Gibergues. « Beaucoup de collègues ne savent pas comment aller à la rencontre des parents, ce qui est pourtant la première chose à faire en maternelle, note Sylvie Lenoble. Pourquoi ne pas mettre en place des formations d’entretien avec les parents dans le cursus des enseignants ? » Autant de points qui devraient nourrir un des débats majeurs de la présidentielle : la redéfinition de la mission des enseignants.
Une note « sociale », comme c’est le cas dans certains pays d’Europe du Nord, doit-elle compléter le bagage du pédagogue ? « Le professeur est celui qui amène un élève d’un point A à un point B. Le point B consiste-t-il, pour l’enfant, à obtenir un diplôme ? Ou s’agit-il de l’aider à se construire, voire se reconstruire ?, demande Armelle Gardien, documentaliste, l’une des chevilles ouvrières de Réseau éducation sans frontières (RESF). Je ne crois pas qu’un enseignant puisse encore se limiter à la transmission des connaissances. Il lui faut s’adapter au public, tout en étant vigilant à ne pas jouer le rôle du papa ou de la maman, ni des professionnels qui ont les compétences. »
Créé en 2004 et fort aujourd’hui d’un listing de 36 000 sympathisants (profs, parents, militants associatifs…), RESF continue plus que jamais à mobiliser ses forces au cas par cas, comme actuellement autour d’un jeune Marocain d’un lycée professionnel des Hauts-de-Seine ayant reçu une obligation de quitter le territoire, et qui – pur hasard – se trouve être le meilleur élève de sa classe. « Voir cet élève partir serait la négation de ce que l’on entreprend, appuie Armelle Gardien. On ne peut pas, d’un côté demander aux jeunes d’avoir confiance dans la parole des adultes et de croire à la construction d’une société plus juste, et de l’autre côté fermer les yeux le jour où ils se retrouvent sur la case départ. »
– « Même s’ils sont en situation irrégulière ? », demande-t-on.
– « Même s’ils sont en situation irrégulière, oui », répond-elle.
Frédéric Potet et les journalistes d’ « Une année en France »
La sous-déclaration et la sous-reconnaissance des maladies professionnelles en France (1990–2020) : revue de littérature pluridisciplinaire
En France, la sous-déclaration et la sous-reconnaissance des maladies professionnelles sont des...