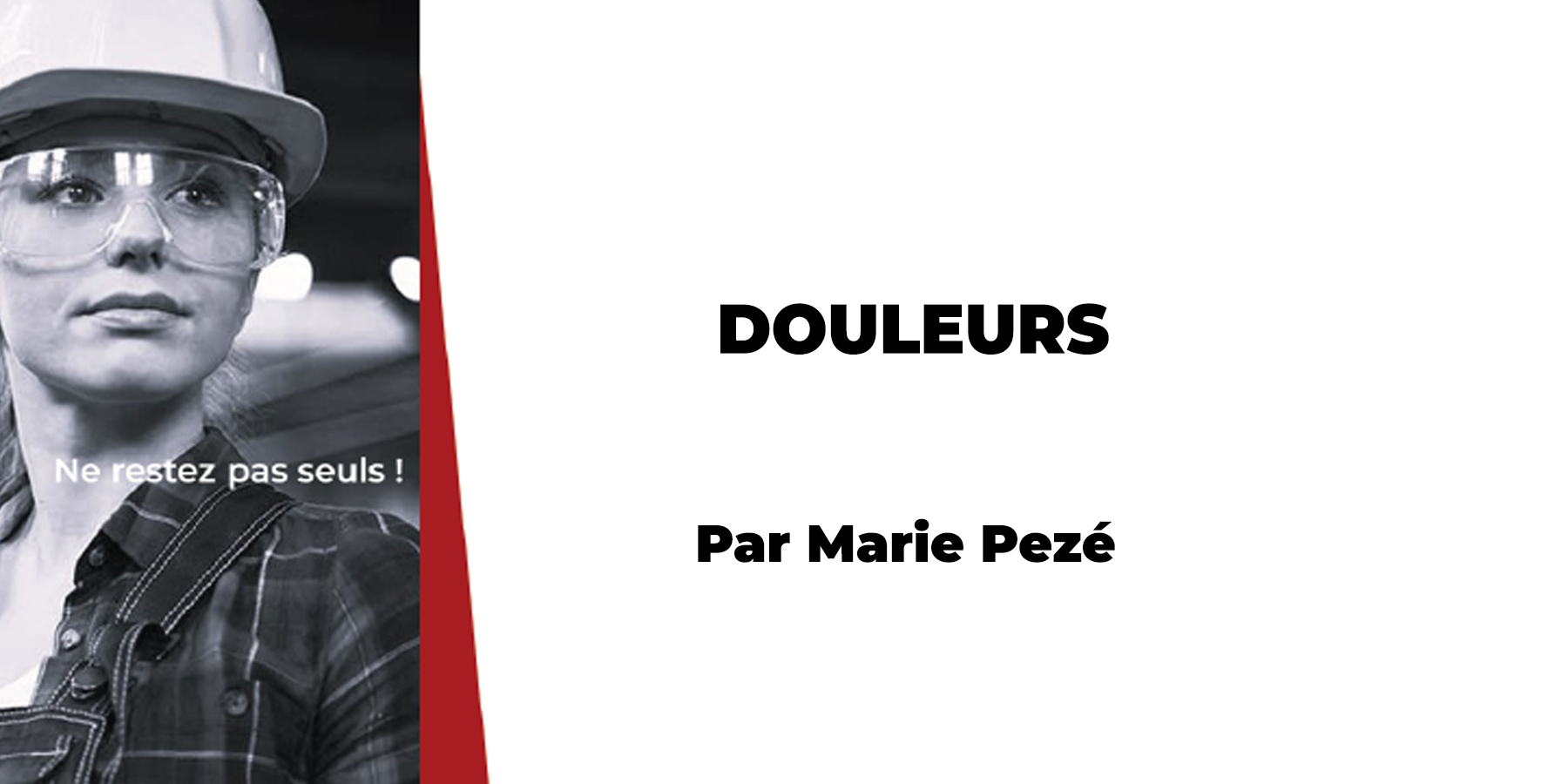Résumé : Marianne vient consulter pour des douleurs physiques intolérables, mais c’est toute une vie de renoncements, de violences et de deuils enfouis qui s’exprime à travers son corps. Enchaînant les emplois précaires et invisibles, elle s’épuise dans un activisme défensif pour ne pas sombrer, offrant un corps docile à une organisation du travail aveugle à sa souffrance. C’est dans l’espace sécurisé de la relation thérapeutique, au croisement du soin et de la reconnaissance, qu’un travail d’élaboration devient possible. À mesure que la douleur se tait, la subjectivité se remet à parler : une parole politique sur les impasses du travail féminin se fraie un chemin.
Quand le corps hurle ce que la parole retient
Tout comme l’activité de penser ne se situe pas seulement dans le cerveau mais passe par le corps tout entier, la souffrance est un vécu psychique incarné, elle est vécue dans la chair.
Dans notre système médical, les patients formulent leur plainte dans un registre uniquement corporel. En écho, les médecins y répondent avec une formation médicale qui ne prête guère qu’à l’interprétation des symptômes organiques.
À ce corps fragmenté par la dissection anatomique, il manque cependant la propriété d’énoncer son histoire. L’incarnation de la souffrance précède souvent la parole sur la souffrance.
Marianne est une jolie jeune femme brune de 32 ans, qui vient nous voir pour d’insupportables douleurs. Le tableau clinique est classique : motricité rétractée, épuisement réactionnel, effondrement dépressif, repli affectif et social. La douleur dévore tout sur son passage.
Il va falloir déplier ce tableau : le corps physiologique avec un bilan complet, le deuxième corps, érotique, et qui, là, semble s’être perdu, le corps au travail enfin. Sans oublier le nôtre, le corps des thérapeutes.
Être thérapeute ne passe pas uniquement par l’apprentissage des grilles nosographiques [1] et la maîtrise intellectuelle des données cliniques. Le travail du psychanalyste n’est rien sans la mobilisation du corps, du charnel.
S’éprouver soi-même pour éprouver l’autre. Encore une fois, la psychanalyste n’a qu’un outil, elle-même. C’est de la rencontre entre deux subjectivités incarnées, de la qualité de cette saisie première que peut naître un travail, oui, un travail d’élaboration. Alors, déplions.
Une vie de renoncements : entre devoir familial et travail sans visage
Marianne est l’aînée d’une fratrie de 11 enfants. Sa mère était déjà diabétique et cardiaque quand elle est née. Elle a vite appris à lui faire ses piqûres, à lui donner ses médicaments, à faire le ménage à sa place. Guère le choix, car cette mère malade est aussi la proie de crises de violence. Quand la maladie ne suffit pas pour obtenir ce qu’elle veut, c’est à coup de nerf de bœuf qu’elle frappe sur les enfants. Le mari est dépassé.
Marianne rêvait d’être infirmière. Elle est partie en LEP à partir de la cinquième « pour faire employée de bureau, comptabilité » [2]. Elle a laissé tomber après deux ans de CAP. « J’ai pas été loin ».
Les activités sublimatoires se brisent vite sur la réalité matérielle. La prise en charge de la mère implique de faire l’impasse faite sur les projets personnels pour aider à élever le reste de la fratrie. La scolarité est écourtée, dirigée vers du travail sans qualification, vers des postes d’exécutante, sans lien avec les aspirations profondes de sa personnalité.
« À 18 ans, j’en ai eu marre ; j’ai rencontré mon ami et j’ai tout de suite eu ma fille aînée qui a maintenant 14 ans. C’était un moyen de tout plaquer. 5 ans après, j’ai eu ma deuxième fille, Sophie. Elle est morte à 14 mois d’une mort subite du nourrisson. Je l’ai transportée à la consultation, là dans le couloir devant votre porte. Ils ont tout essayé, ils n’ont pas pu la ranimer. Après la mort du bébé, mon mari a fait une dépression grave, il s’est mis à boire. Je me suis occupée de lui, de l‘aînée, des démarches administratives pour le bébé. Tout, quoi. Pendant sa dépression, je me disais, s’il me lâche entre les mains, qu’est-ce que je fais ? Je viens déjà d’en perdre une. Deux ans après, j’ai eu mon fils pour lui faire plaisir. Moi, c’était fini, je voulais plus d’enfant ».
…
L’intégralité de l’article est téléchargeable gratuitement
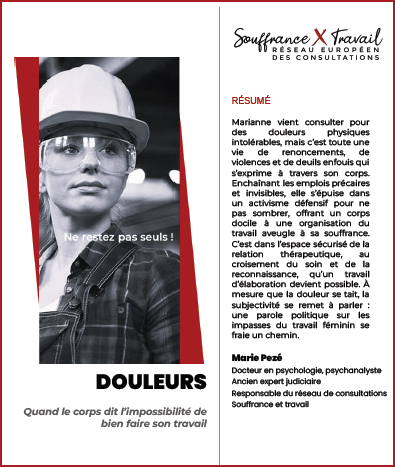
———————-
[1] NOSOGRAPHIE, subst. fém. MÉD. Description et classification des maladies d’après leurs caractères distinctifs. (Source : https://www.cnrtl.fr/definition/nosographique). [2]Les itinéraires professionnels de nombreuses patientes ont été recueillies par Nadège Maréchal, sociologue.SOUTENEZ L’ASSOCIATION SOUFFRANCE & TRAVAIL fondée en 1997 par Marie Pezé !
L’équipe Souffrance et Travail est entièrement bénévole : les membres de l’association qui a créé le site, les contributeurs, la rédac chef, et le webmaster. Tous les frais sont à notre charge, même l’hébergement du site, qui est désormais conséquent car nous recevons plus de 30 000 visiteurs par mois.
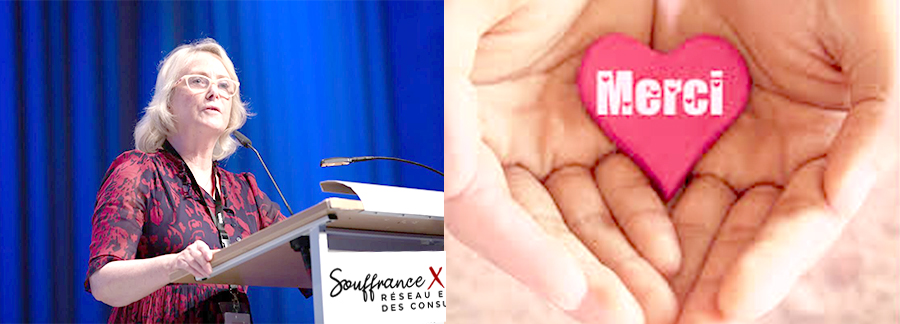
DCTH, Diffusion des Connaissances sur le Travail Humain, est une association Loi 1901 d’intérêt général. Vous pouvez donc soutenir notre action en envoyant un don, déductible à 66 % de vos impôts (article 200 CGI). Un reçu fiscal vous sera délivré.